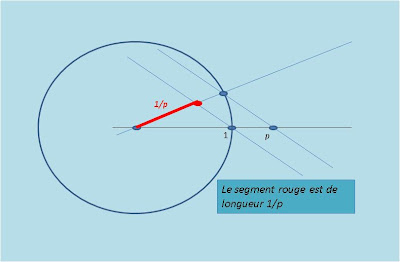Un peu de musique sur ce blog : cela adoucit les mœurs – quoique... Récemment je me retrouvais à travailler Thème et Variations d’Olivier Messiaen pour piano et violon et ce qui longtemps me rebuta autour de cette œuvre, c’est la bonne compréhension du langage musical si particulier du compositeur. Notamment, on sait qu’il avait pour habitude d’utiliser des modes, dits « modes 1 à 7 », correspondant à des divisions arithmétiques de la gamme. Ah ! Il n’en fallait pas plus pour que je me penche sur la question : pourquoi 7 modes ? pourquoi ceux-là ? etc. Tout ce qui va suivre ne m'a pas complètement aidé à tout comprendre, loin de là, mais cela m'a paru valoir le coup d'être développé un minimum.
Pour commencer, la gamme chromatique est composée de 12 sons placés de ½ ton en ½ ton, si bien que la gamme est une division « régulière » (en termes de tons) de l’octave Do-Do – n’en déplaise à nos amis violonistes : nous oublierons ici les quarts de ton et autres micro-tons propres à leur art. Donc, la gamme, c’est Z/12Z, un demi-ton, c’est +1 et un ton c’est +2. Trêve de plaisanteries : on passe aux maths et si je vous dis « La bémol », en fait c’est 8.
Si bien qu’un mode, en tant que sélection de notes parmi les 12 sons de la gamme, c’est en fait une partie de Z/12Z. Ainsi, parmi ces modes, il y en a des triviaux : Z/12Z lui-même qui n’est autre que l’ensemble de la gamme chromatique, et les singletons {Do}, {Do#}, …, {Si} (ou {0},…,{11}) qui sont les gammes les plus dépouillées qui soient, puisqu’elles sont composées d’une seule note.
Pour aller un peu plus loin vers les modes de Messiaen, on va parler de modes équivalents, ou modes « transposés ». En fait, en musique classique, la « gamme » (1) de Do majeur et la « gamme » de Ré majeur sont en fait une transposition l’une de l’autre : dans notre analogie avec Z/12Z, on remarque que la notion de « transposition » correspond à l’existence d’un entier k de Z/12Z telle que (Ré Majeur) = (Do Majeur) + k (en l’occurrence, k = 2 ici). En revanche, Do Majeur et do mineur ne sont pas transposés l’un de l’autre. Bref, la relation « est transposé de » est, au sens mathématique du terme, une relation d’équivalence parmi les modes : dorénavant nous parlerons de « modes équivalents ». Autrement dit, un mode A est équivalent à (ou transposé de) un mode B s’il existe k dans Z/12Z (ou, en musique, un intervalle fixe) tel que A = B + k. Ainsi, à équivalence près, il n’existe que deux modes triviaux : Z/12Z entier ou le singleton {Do}. De même, à équivalence près, on peut considérer que tous les modes commencent à Do – ou {0}.
De la même manière, on peut introduire la notion de « mode périodique » et examiner la musique à travers cela. Nous appelons « mode périodique » un mode A tel qu’il existe k dans Z/12Z – {0} tel que A = A + k (2). Ainsi la période est le plus petit entier k (non nul) tel que A = A + k. A contrario, un mode est dit apériodique s’il ne présente aucune période et on voit que c’est le cas des modes « classiques » majeur {0,2,4,5,7,9,11} et mineur {0,2,3,5,7,8,11} – faites l’exercice, vous verrez que c’est bien le cas. De même, le mode pentatonique de Debussy {Ré b, Mi b, Sol b, La b, Si b}, dit « mode chinois » et basé sur les touches noires d’un piano, est également apériodique.
Une propriété à peu près immédiate est qu’un mode périodique non trivial ne peut avoir une période première avec 12. En effet, si un mode A présente une période T première avec 12 et si n est une note de A, alors n+kT (pour k entier naturel quelconque) est aussi dans A ; or il existe k dans N tel que kT = 1 [12] d’après le théorème de Bezout, donc A finit par contenir toutes les notes de la gamme.
Ainsi, un mode périodique non trivial a forcément pour période 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Remarquons d’entrée qu’un mode de période 10 (septième mineure) est aussi de période 2 (seconde majeure) (A = A+10 = A+50 = A+2) – de même un mode de période 8 (sixte mineure) est de période 4 (tierce majeure) et un mode de période 9 (sixte majeure) est en fait de période 3 (tierce mineure). En gros, 8, 9 ou 10 ne peuvent être des « périodes » à proprement parler car la période est censée être le plus petit intervalle d’ « auto-transposition ». Ainsi, les seules périodes possibles sont 2, 3, 4 ou 6.
Examinons maintenant les modes de Messiaen :
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Modes 4 à 7
(source : Wikipedia)
Le mode 1 est un mode de période 2 : c’est en fait le seul mode non trivial, à équivalence près, de période 2. En effet, si on commence à intercaler les demi-tons, alors on obtient toute la gamme chromatique.
De même, le mode 2 est de période 3 et c’est presque le seul, à équivalence près, à être non trivial. Le mode suivant n’est pas réprésenté par Messiaen : {Do, Mi b, Fa#, La} ou {0,3,6,9}, représentant l’accord de septième diminuée. A ce stade, nous faisons remarquer que les gammes de 4 sons ou moins ne sont pas à proprement parler considérées comme des « modes » en Musique : un mode doit être au minimum pentatonique (comme par exemple le mode "chinois" évoqué plus haut, utilisé dans la musique de Debussy au début du XXème siècle). (3).
Le mode 3 est de période 4 mais ce n’est pas le seul possible : cette fois, il en existe deux autres, à équivalence près, non représentés par Messiaen.
- le premier qui itère le schéma ½ ton + tierce mineure – dans Z/12Z : {0,1,4,5,8,9}, en musique : {Do, Ré b, Mi, Fa, Sol #, La}
- le second, qui décrit l’accord de quinte augmentée – {Do, Mi, Sol#} ou {0,4,8}.
Les modes 4 à 7 sont, quant à eux, de période 6. Manquent à l’appel 5 modes 6-périodiques non triviaux :
- {Do, Fa#} = {0,6} : la quinte diminuée qui partage la gamme chromatique en deux
- {Do, Fa, Fa#, Si} = {0,5,6,11}
- {Do, Mi, Fa#, La#} = {0,4,6,10}
- {Do, Réb, Mib, Fa#, Sol, La} = {0,1,3,6,7,9}
- {Do, Mib, Fa, Fa#, La, Si} = {0,3,5,6,9,11}
Au total, si on élimine les modes présentant 4 notes ou moins, non considérées en musique comme des « modes » à proprement parler, alors on a le résultat suivant :
Les modes de Messiaen composent 7 des 10 classes d’équivalence de modes qui présentent la propriété d’être périodiques et non triviales.
Pour conclure, on ignore aujourd’hui si Olivier Messiaen avait cette arithmétique en tête. Toutefois, sa classification des modes laisse fortement supposer qu’il avait l’intuition de la notion de période et sa musique ne laisse aucun doute quant à sa maîtrise de l’équivalence des modes. Chapeau, l’artiste !
Notes
(1) En fait ce qu’on nomme classiquement « gamme » de Do majeur ou « gamme » de Ré majeur etc. est dans notre terminologie ce que nous appelons un « mode », étant donné que c’est un sous-ensemble de la gamme chromatique.
(2) Il est évidemment important d’enlever k=0 sans quoi tout mode est périodique – à cause de la réflexivité de la relation d’équivalence entre modes.
(3) Du fait de ce postulat d’origine purement musicale, nous avons donc exclu les modes suivants de l’analyse :
Période 3 : {Do, Mi, Fa#, La} (septième diminuée)
Période 4 : {Do, Mi, Sol#} (quinte augmentée, qui partage la gamme chromatique en deux parties égales)
Période 6 : {Do, Fa#} (la quinte augmentée sans la tierce), {Do, Fa, Fa#, Si}, {Do, Mi, Fa#, La#}
Cela dit, notons que ces 5 modes, ainsi que les 3 modes non décrits par le compositeur, sont tous « inclus » (au sens ensembliste du terme) dans des modes de Messiaen. Cela dit, parmi les 7 modes décrits par le compositeur, par exemple, le mode 5 est un résumé du mode 6 ; de même le mode 7 est un développement du mode 1, etc.